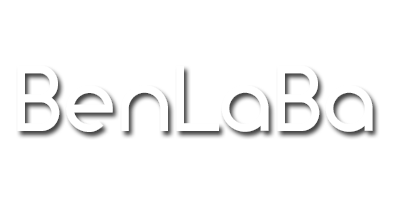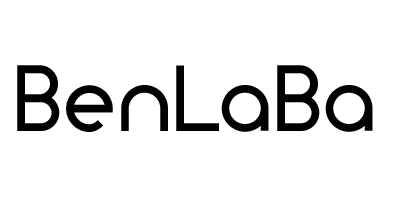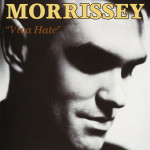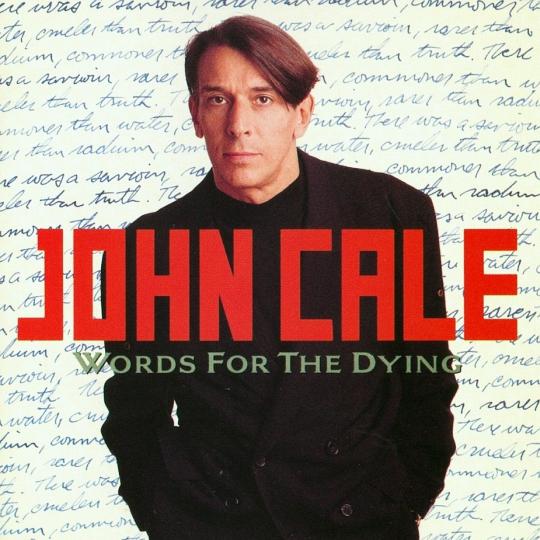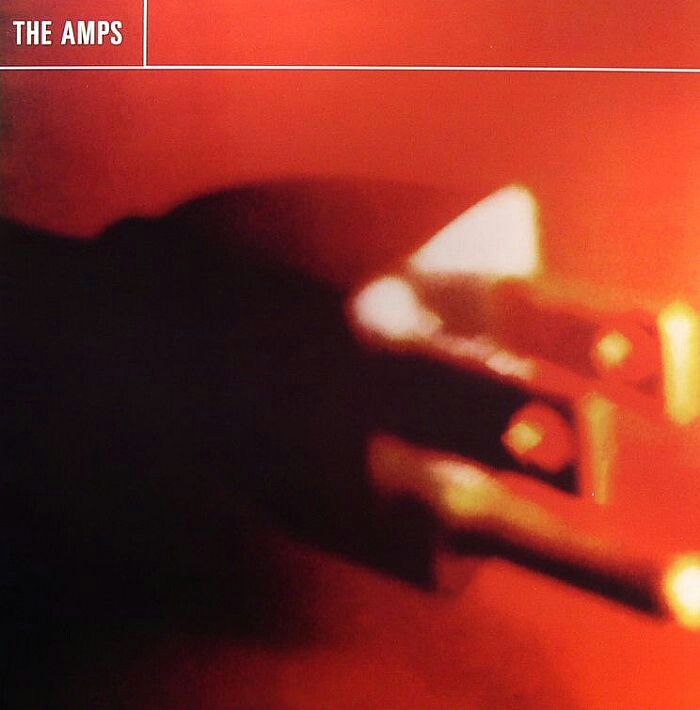***#1La Fossette, Dominique A***
(post du 30 octobre 2015 sur la page https://www.facebook.com/Ben-LaBa-1428922020691382/)
Mon album francophone, car tout simplement mon premier de parmi les gens d’ici, ou de là, enfin là-bas, quelque part, probablement nulle part et partout, donc… Certes y avait bien eu Claude MC avant, mais niveau rock pop indé.fr, c’est mon point 0. D’où ce premier post d’une série de là-baseries, des b à ba, des bases de vie d’ici en-bas. Les textes d’une voix perdue sous les boîtes à rythmes Casio genre premier jeux sur Amstrad ou… ? Et les guitares distordues maison. Un son d’une blancheur d’eau glacée, courant et roulant d’un mont solitaire aux flancs réchauffés de soleil. De neiges en hiver, lents à plats de « février ». D’oiseaux isolés du vacarme d’en-dehors. Nuit comme jour… Comment un live de ceci sonnerait-il d’ailleurs dans telle ou telle ville, tel ou tel concert, la nuit ? « Folie des hommes » et séparation des cœurs. Vivement l’espoir des échos glanés dès que possible comme ces « Dimanches » gris, certes, mais aussi blancs et noirs… Merci infini pour la liberté accordée à Mr A par Bernard Lenoir et ses acolytes dont les sessions d’alors faisaient mes nuits, mes jours, un peu avant que je ne touche ma première guitare. Inconsciemment ça ressemblait déjà à une liberté toute ivre d’alternative à l’industrie du mal-ouïr. Merci donc à mes frères pour l’introduction à Lenoir et sa musique « pas comme les autres ». Faussant compagnie au monde, tel une frêle fauvette dans ses envols furtifs vers un ailleurs toujours insaisissable, voilà comment ce fol ami des anges et des cieux fit sonner 1993 par chez moi. En français, pour presqu’une première fois. En 1994-1995, avec les Seek Extense! nous reprenions en concert Les Hauts quartiers de peine du troisième album de notre aîné, Dominique Ané.
Cet album est à peu près celui de ma maturité musicale. Je l’ai acheté dès sa sortie, en nineteen eighty-hate, avant mes 11 ans. Je ne me souviens pas avoir acheté d’album avant celui-là ; profitant des accumulations de mes parents, frères et soeur aînés pour me tenir dans cette sorte de courant que la mode alternative musicale portait jusque dans l’hexagone par ces anglophones d’à-côté, ou d’en face… Les Smiths avaient été mon école en ces 80’s, tout comme l’avaient été Police, les Cure qui allaient continuer de l’être jusqu’à Wish, ou Joy Division/New Order. Morrissey going solo ? Tout un programme ! Avec lequel je me suis finalement senti d’emblée beaucoup plus à l’aise qu’avec la plupart des choses entendues ici et là à cette époque, voire même depuis… Parsemé de classiques – oui encore près de 30 ans après, cet album (merci Stephen Street) contient des pièces majeures parmi lesquelles mes favorites qui sont souvent oubliées des commentateurs. Ce qui m’a le plus touché, outre la voix du Moz, ses propos hors norme, c’est la guitare de Vini Reilly : chef d’oeuvre. La justesse et la douceur de ses delay, son toucher en général, y compris folk et classique, relevaient le défi de l’après Marr. Un bonheur empreint d’une étrange mélancolie, de confiance en soi malgré les épreuves, un désir de (se) plaire à nouveau au-delà des choses accomplies, de se refaire, de se revoir en face à l’approche des crises de l’âge, des virages adultes, des abandons amicaux, des ruptures amoureuses… « Vive la haine », c’est-à-dire celle par laquelle on peut/doit parfois passer afin d’en tirer le meilleur, à nouveau, car rien ne tient en temps de crise, de désamour. « Viva Hate » serait alors bien plutôt pour moi un synonyme de « Merci l’Amour » et peut-être, aussi, l’est-il en ce palare (parler des gens du spectacle et de la rue anglaise, des gays faisant le trottoir, minorités slangant leur vie en pays dominant). On n’est pas à un renversement près avec le Moz et sa poésie pratique, taillée aussi courte que ses côtés et sa nuque par d’improbables hairdressers souriant aux muses animées un temps par Oscar Wilde… Nous sommes tous des enfants de l’amour et de la haine (merci Cohen de l’avoir titré). Des enfants de musiques violentes, rageuses, calmes, douces comme une caresse consolante ou brutale comme une claque exportant la démence des passions. Heureusement que d’autres, les artistes, les vivent pour nous parfois… Mais musique et vie réelle ne sont ici pas comparables : quel attentat haineux a-t-il déjà eu lieu en musique ? En 1988 Morrissey réussissait sa traversée de désert. Bien d’autres allaient encore se présenter devant lui… Lui que certains portraiturèrent en coupable, fat et repus, lâcheur du groupe. Ignare et inutile. Mais pour moi, dans ma chambre de pré-ado, poster du single Suedehead sur le mur (auquel, sans l’avoir prémédité, j’ai une témoin, ressemble ma pochette du « Train »), ce disque annonçait des choses plus profondes, personnelles, esthétiques, sensibles, vécues. Ce que je ne réaliserai que quelques années plus tard, prenant une guitare… (chute de guillotine)*
Albums de là-bas #3, 4 et 5
(post du 4 février 2016)
En 1989, j’achetais mes premiers disques CD. Trois allaient devenir majeurs pour moi, hors du commun. Quand le cerveau est encore libre de droits, libre de franchises, libre de pistes traversant plaines, forêts et montagnes, avant que la main de l’homme n’aie touché le sauvage et le naturel, eh bien tout est plus chatoyant, vibrant, imprécis et libre car indéterminé ; magique. Après, ce n’est plus le cas. La trace est faite. Le cerveau a ses « avenues de mémoire » (cf. mon « Avec Juliana »). Des passages sont ouverts pour toujours, souvent aux dépends de ce qui se trouvait à côté, en marge de ces autoroutes cognitives maintenant tracées à jamais. D’où l’importance de l’éducation, musicale ou autre. Car si l’art ouvre, il ferme tout autant.
**** Grâce aux Finlandais pas déprimés de 22 Pistepirkko (ils sont toujours en vie alors que le taux de suicide est assez élevé dans leur pays…), j’ai noué ma vie musicale avec une tradition « blues-rock de Blancs à l’esprit foutraque ». Quel album que ce Bare Bone Nest. 10/10. Belles mélodies, collages d’ambiances, bruitages, jubilations criardes, slide guitars et claviers aux sons douteux, drums maison et hélicoptères en pleine décharge des temps modernes, Frankestein toujours prêt à surgir dans l’angle mort des visions anguleuses, et puis ces eaux de Bayou… immobiles bien que dégelées, ou comment des Scandinaves suent le Sud des Etats-Unis !!! Merci encore les gars, euh pardon, les coccinelles, pour l’ouverture tous azimuts et l’humour classe « 22, v’là le blues-rock ».
**** Il est entendu aujourd’hui que Paul’s Boutique des Beastie Boys serait impossible à faire en ce 3e millénaire et ses droits d’auteurs hameçonnés aux croques la mort des ondes de choc. Plus moyen de sampler en paix, ni de voler ou de piller le passé pour le refaire vivre ? Si si, l’esprit reste, caché sous la loi, pas de doute. Mais quand même, c’est un fait, on n’entendra plus autant de liberté chapardeuse en musique. Ces gars-là, un autre trio, sont (étaient) des génies, du punk à la soul, du rap aux autres innovations qu’ils nous ont concoctées. Cet album est un must. On entre et on sort par des morceaux à cent mille lieux de ce qui existe. Au milieu, sous les millions de mots amassés en décharge postmoderne, là encore, on entend de tout, on danse sur tout, on s’amuse de tout et on jubile à entendre alterner les 3 flows bestiaux de freluquets blancs-becs roulant leurs vie urbaine à 300 à l’heure. Héritiers de mondes musicaux multiples, leur folie et leur humour juïf n’en auront pas moins alimenté une nouvelle tradition, que donc, les pro du spectacle auront essayé de tuer dans l’oeuf (cf. « Egg Man »), à moins que…
**** Dylan Thomas est né un 27 octobre au Pays de Galle. Son nom a influencé Bob Zimmerman quittant son Minnesota natal et s’inventant des vies dans les trains qu’il prenait vers l’Est. Il a écrit la voie lactée des nouvelles heures, pas mal éthylique sa voix d’ailleurs… Et vers la Swansea Bay, un autre Gallois lui a emboîté le pas. John, l’ami de Lou, Terry et Mo et ami d’enfance mienne avec ce Velvet en marge, avec la grande soeur, blonde, Nico, éternelle beauté sauvage. Orchestre classique, sons de Eno (cf. « Carmen Miranda »), voix de nez et piano annonçant la suite des Halleluyah, John frappait fort dans mon cerveau alimenté au classique en donnant des airs rock et pop aux Russes jouant ici. Le James Dean réincarné des photos du livret m’a toujours frappé aussi. Cet album, entre chaud et froid, entre morts et vivants, entre ici et là, refuse l’abandon gentillet (cf. « Do not go gentle… »), y compris de la part du choeur d’enfants, face aux affres du vécu, fussent ceux nécessaires de la mort, de la défaite. Dans le « Song without words #2 », on entend un relent du « Bist du Bei Mir » de Bach, lequel est aussi dans ma « 4 Elements Girl »… On lâche rien, on continue* Peace & Music Openess*
**//** Album de là-bas #6 **\\**
Parfois, comme on dit, on « traverse » un moment difficile. On se réveille alors chaque matin comme dans un cauchemar (et non d’un). Les choses ne sont plus ce qu’elles étaient ou devraient être demeurées. Les vieilles manies ne payant plus, les monnaies de nos pièces sans banque ni route, sans building ni char d’attaque, rendues en quelques maigres ferrailles qui, accumulées tant bien que mal, font comme elles peuvent pour donner du vivant capable de se maintenir tant bien que mal sur quelques centimètres cubes de chairs et d’os lesquels ne fonctionnent plus comme prévu, comme devraient, comme pour de vrai. Bon, ça c’est pour avant. Ou plutôt pendant. Car tout ce qui ne tue pas grandit, n’est-ce pas Nietzsche ? Un jour ça passera plus, certes. A moins que… Mais pour le moment, si. Sur ce moment, si. Et c’est là, traversant ce moment difficile, que je suis retombé, il y a bientôt deux mois, déjà, sur mon CD de Anthem of the Sun du Grateful Dead acheté y a 10 ans. C’est là que je me suis dit : « Oui, je suis mort » et que, dans un sursaut de vie auquel cette musique n’est pas étrangère, je me suis sentis réinvesti du souffle et du tympan, du battement de coeur, du gonflement des alvéoles, du pouls des pas poussant le petit vers le Grand Tout avec une infinie gratitude. Une sorte d’acid trip sans trip ni acid… Mais une chose que sait rendre ce groupe, organique comme rarement musique de Blancs fut, est bien celle de la floraison, de la lente mutation des formes allant vers leur accomplissement, leur maturation et donc vers la révolution larvée comme jubilante d’une vie annonçant déjà son passage et sa prochaine décroissance. Chose sue d’emblée, jamais oubliée, mais conjurée à chaque instant ici comme l’est précisément le silence, si présent chez le Dead, entre les tresses de cordes et les micro-impacts de baguettes. Les voix multiphones et les auras étoilées de chacune des ouvertures proposées par ces morceaux sans architecture lisible immédiatement (à l’exception toute irrégulaire de « Born Cross-eyed », un single de 2’06 » dont la charpente est des plus improbable) que l’on découvre précisément dans toute la durée fractale d’un monde en pleine réalisation immédiate, en pleine « traversée » d’un œil de cyclone, ces auras étoilées dis-je m’ont une fois de plus rappelé combien ce fut bon les 60’s vers la Californie.
Jamais deux prises, deux live identiques, en 16000 fois comme le chiffrait Bob Weir dans The Other One sur plus de 50 ans de carrière… La vie quoi, la vraie. La musique éternelle, en route, sur les chemins de traverse. De nuit, de jour. L’Amérique blanche et métisse de l’ouest à son meilleur. Les Merry Pranksters de Kerouac à Wolfe… Les cousins Arthur, Jim et compagnie… Les jaloux des villes sauvages n’ont qu’à bien se tenir ! Mais surtout « Caution, do not stop on the tracks ».
Les histoires griffonnées sur les cavernes mentales des participants des soirées où revivait, encore et pour toujours dans l’infini, car vécu à chaque micro-instant, la musique du Dead, sont encore à écrire en tout cas. Perso, je n’y étais pas…………….* Hymne au soleil donc. Liberté totale. Perfectionnement des arts et des joies… Un groupe comme aucun autre et un album à part dans leur œuvre, il me semble. Avec ses mélanges de live et de studio, ses collages de bruitages et de transitions groovy-patchouli, avec ses doubles drums et ses lonesome Other Ones réunis en un Grand Petit Tout… Une des grandes expériences de 1968 assurément que l’on peut revivre à l’envie, sur table tournante, numérique ou pas.
*Bonne mort (lente si possible) les amis*
/=\ # 7 # 7 # 7/=\Г§~ฯ
Album de very là-bas : The Mabuses (1993)
(post du 30 mai 2016)
Ouais j’abuse un peu avec ces histoires musicales miennes… Mais s’il y avait un truc à partager car moins majoritant que d’autres, genre un truc mal connu, pas su, pas vu et pourtant gros, énorme en fait, du moins dans ma cabeza melomaniale, eh bien ce serait ce disque des Mabuses. Pas les doctes doctants d’une folle pataphysique molle et pourtant tellement plus consistante que bien des affaires en circulation. Non. Mais le premier album des docteurs désabusés mais rabusant d’embûches trésaillantes et sonnantes toutes muses et abbés confondus dehors, de A à B puis Z…
Si je ne m’abuse, ce groupe n’a rien fait d’autre d’écoutable, aussi étonnamment que je vous le traduise. Certes dans la trace qu’a sillonné ce disque en moi les guitares insistantes abusant quelques peu de lignes étranges (mais quelle dope prenaient-ils ces psyché d’un ailleurs indé-modable ? Peut être bien aucune… à part la bullante dont le morceau folk de marins à la fin semble tout droit évaporé) sont pour beaucoup. Les voix aussi, bizarres en un mot. Les beat, les inattendus, les courses mélodiques insistantes…
Donc les Mabuses ont eu, une fois au moins, tout juste. En moi une fois au moins en eux aussi sûrement, sur le nombre relativement élevé d’écoutes… Allé, une estimation : moins de 50 fois. C’est relativement peu car vu le contenu c’est beaucoup plus ! La bonne volonté de l’auditeur, vous connaissez ? Celle par laquelle on arrive ailleurs, venant d’ici, allant là-bas, projeté, déplacé, remué, ému, mu, laissé allé, échappé, perdu, envolé… Comme un pigeon, qui saît, qui s’est pris un coup de pied de Kim Fahy et sa bande surréaliste. Coup de pied au cul devenu du fait « Cu(L!)bicle », quel morceau… Avec mon bagage du moment, vers le début des 90’s, ça a sonné comme une symphonie pop donnée par 4 gars, grosses envolées lyriques des boucles de chorus et de claires fontaines dédiées au monstre souverain du roulant beat des formes magiques et musicales voltigeant en boucles folles sur les eaux du verbe et des planeurs liés d’électricités parentes et fusillées-nées de la matière inerte des silences engorgés. Une vacance au sein du Collège plus ou moins physique et pata.
Allez, let’s KICK a PIGEON ! on saute et, surtout sans lui faire de mal, pour qu’on s’envole avec, et, en un plongeon de chez les PIGS qui déraillent de partout chez nous.fr pendant de nouvelles manifs, on creuse le sillon de la résistance, du réveil de l’emploi à temps impartiels, de la vocation dévouée aux arts des formes nauséabondes abondantes pour le monde mourant des hommes en costards gratuits si propres… Rien à voir avec les docteurs je vous disai. Ou alors, et comme on peut le ressentir parfois à l’écoute de cet album, des docteurs qui donneraint la nausée comme exprès, pour rendre malade, pour, au fond, sauver leurs patients des choses lichées, lissées, aplanies, dégriffées…
Si ça fait mal à la tête, j’ai toujours pensé que c’était voulu. *Maljour chez vous les volontaires!*
—***–*-#8 Baby Bird, Fatherhood (1995)-*–***—
(post du 22 septembre2016)
Vers le moment de ma sortie de ma ville natale – vous savez genre cette small town dont parlent Lou et Cale dans Songs for Drella -, j’ai dû acheter ce disque en la sainte ville rose, histoire de perdre son con : Toulouse cong (pas très King en tout cas, merci). Et puis, bien que déjà connaisseur des errements endémiques d’un Chris Knox, l’homme-solo-holiste de New Zealand, j’ai pris cher. J’en comprendrai encore à peine la portée si je n’étais moi-même devenu papa… et musicien. Un disque fait main, un des lo-fi albums d’un pauvre perdu d’Albion que le Génie Poétique habitait alors (avant sa sortie sur les écrans des craneurs à cran sachant craner le monde de l’art et des cochons rosebeaf…). « So far away like Neil Armstrong » il se savait loin ce Mister Jones dont l’âge de maturité – lequel était-il craint, regretté, perdu, trouvé ? je ne le saurai jamais sans plus d’investigation, ce que l’ère pré-internet ne permettait d’ailleurs guère pour des pèquenots sans droit au chapitre – se situait bien loin de l’âge d’homme des Hommes communs.
Et pourtant ils étaient bons ses sons, bonnes ses compositions éperdues par lesquelles j’ose espérer qu’il se trouvait avant de donner des concerts partout et de, peut-être, tourner son petit oiseau en ridicule grenouille voulant boeufer. A l’époque il disait « We got all the Time in The World », il enregistrait à la maison, il envoyait tel un Daniel Johnston ses bouteilles à la mer, laissant ses auditeurs l’aider à trier dans ses démos quels titres devaient être repris pour un éventuel album. Celui-ci vint après cinq-six disques de démos et ce fut un échec esthétique quasi-total selon le néo-toulousain qui venait de perdre un ami au ventre pourtant rond de promesses. Un mauvais coup de rasoir ce « Ugly Beautiful » de 1996… Perso je n’aurai jamais osé couper dans ce Fatherhood, pas même les trois titres d’easy listening (chose abominablement kitsh et d’un goût probablement so british) qui sont à siroter sur une plage (froide d’Albion donc, cette ‘Alluminium Beach » où ils nous réchaufferaient certainement). Pas plus d’ailleurs je n’ai cherché ses autres disques, pensant magiquement que rien n’égalerait celui-là. Qui sait, bientôt je trouverai le coffret lo-fi ? (Choses faite ce 16 octobre 2016 et dans le livret duquel on lit que ce 3e album est son « finest achievement to date »)
Tant et tant de contenu dans ces 20 titres dont les quelques grands moments de grâce naïve, notamment poétique, ou les humours visuels (pochette) comme chantés – en froggy Man, du jamais vu ! ( » Oulalala mais oui, c’est la vie, c’est moi ») – nous donnent une idée de ce que serait, ou de ce qu’est ce monde, loin des hi-fi et des industrieux de l’art. Mes amis… Ahlalalalala où à qu’bar qu’on y joue un peu ? Encore et encore. Quelques bars à spectacle… Quelques barres de mesure plus tard…
La retenue des voix superposées, les guitares carillonnant, les drums parfois absents, les basses lyriques, les effets normaux et les grichements du studio maison… Merci Jones pour cette impression d’être chez toi, reçus comme des invités de marque, intimes choyés à notre tour de tant de générosité et de franchise, fussent-elles anguleuses comme l’Angleterre. La liberté d’un homme aux prises avec ses affects, soit le déterminisme artistique libre et rayonnant en pleine atmosphère… Rare. Rare comme un oiseau à peine né. Comme un climat jamais connus mais capable de durer tout le temps du monde, toute une vie comme l’avant-dernière chanson, « But Love », l’exemplifierait à elle seule. J’appris hier que l’oiseau avait pris son envol et changé tout récemment de nom. Alors on se croise en l’air! Bons vols les amis***///***\\\***
Albums de Là-Bas //*Mention SPÉCIALE*, sans numéro : MADAGASCAR##
22/12/16
A l’approche de Noël, fête du solstice, fête solaire au cœur des noirceurs, fête des valeurs essentielles de la paix des cœurs et des familles, de sang ou non, des générations entremêlées rassemblées dans le savoir des continuités et des transmissions, je voulais vous dire combien je suis heureux d’avoir rencontré Madagascar sur ma route mélomane. Ce fut par La Réunion. Ce fut avant La Réunion par la compil Houn Noukoun. Ce fut de tout temps car ces mélodies synthèses du monde sont en chacun depuis l’origine. Cette île incarne à mes oreilles, qui n’ont pas eu la chance peut-être d’en entendre plus, la quintessence de la spiritualité. Je dis cela sans compétition bien sûr : ici c’est la convergence qui prime. Toutes les expressions musicales transposent sur terre l’harmonie des sphères. Et Madagascar y parvient à sa façon, enfin à ses façons tant l’île est vaste et riche de cultures. Que l’on y aille avec l’accordéon, la tromba, les chorales, les cordes… que l’on danse ou prie, cette île sait depuis toujours que l’homme communie, vit par la mise en commun, le partage et le dépassement des choses matérielles. La communication avec les morts, la communication avec l’ailleurs, l’ici, tout y est réenchanté. Que de bonheurs à rencontrer Madagascar à travers Vaovy, D’Gary, Jaojoby, Salala, Fenoamby, Régis Gizavo, la valiha, le kabosy, les disques Ocora, le Hira Gasy, le tsapiky, le rimotsy…
Dieu a créé Madagascar et Madagascar s’en souvient en le louant. Les racines du bananier repoussent ici et là, elles reprennent l’antique refrain de l’homme se sachant engendré. Etant, à ce titre, éternellement reconnaissant il se sait devant agir selon les lois d’harmonie que fixèrent les ancêtres. Ensemble, contre les colonialistes, contre les mauvais profits, contre l’erreur humaine, dansons ! Chantons ! Jouons ! Louons!
Madagascar, pour moi -pauvre en esprit n’y étant jamais allé, et donc étant comme tant de fans ne connaissant pas la réalité de l’objet de leurs admirations- est encore cet horizon idéal(isé) de vie rouge terre sang dans lequel vivent les meilleurs espoirs de l’homme. Zanahary et tous les Saints, prions pour lui! Prions aussi pour l’homme, qu’il ne se perde plus, qu’il trouve la force de continuer l’œuvre mystique des premiers temps, qu’il cherche la paix, la fasse tout autant. En lui et au dehors de lui. Notamment en dédiant l’instant à ce Grand Tout qui nous a fait et que l’on vénère, chacun selon nos sensibilités, par voie de « musicosmogonie ». Amour, Santé, Musique à toutes et tous*
https://www.youtube.com/watch?
***\\\***#9 The Amps, Pacer (1995)***///***
(post du 28 avril 2017)
Début 1995, avec les amis du Seek Extense!, nous jouions Metal Man des Breeders (1990) qu’en tant que fans des Pixies on avait spoté, mon frère et moi, dans les journaux musicaux pour commander au magasin de musique de notre ville de campagne, là-bas… Quel album ce Pod d’avant les IPod ! J’ai gardé quelque part une bien drôle de version de cette reprise, enregistrée sur K7 avec des passages de séries tv au milieu… Quand est sorti cet album, à l’automne, je commençais à comprendre comment c’est : études de sociologie et grèves ; même Bourdieu en était. Et ce projet de côté de l’ultime Kim Deal – sans doute le meilleur deal de ce rock masculin et blanc que Kobain dénonce dans son journal…, même si j’ai toujours eu un faible pour sa soeur, maladroite, alcoolique tout autant, mais ô combien belle (cf. dans les rues du clip Saints) et créative comme le montrent ses soli de guitare à deux doigts (deux hyperactives ces filles-là, des filles du last splash assurément), même si on pourrait préférer l’autre Kim, Madame Gordon, cette Kim-là reste l’étoile du grunge américain d’où émane la lumière d’une éternelle jeunesse insoumise et savante et sereine et sage et dévastée et déconfite et reconfite et renversante car en perpétuel détournement culturel. Un activisme à la Kim ! Kim ! Yong-Uh ! Krill pour les baleines rockantes. Kill the Idol, you GigantiKim ! -, ce projet de côté disais-je donc, m’avait, une fois de plus, donné de quoi sauter partout !
Les Breeders ont eu la liberté kimienne de ne pas faire du Frank Black – une méchante bonne école ceci-dit – et on s’en sent pas si mal à l’écoute de ce The Amps où Kim, comme en solo, est avec un trio de gars, sans sa soeur ni Josephine. Le drummer, Jim, des Breeders en fait tellement encore une fois ici, toujours à sortir des ornières rythmiques habituelles du rock et à donner une formule nouvelle à chaque morceau. J’en dirai pas plus car les paroles me sont toujours passées au large, ne retenant que le son… si juste… Une énergie à partager ! Celle qu’on trouve comme on peut, mais qui, quand on la voit, l’entend, nous fait sentir qu’on sait. C’est comme quand tu branches la prise, quand tu plug the amp ! C’est électrique*
Ceux qui me connaissent savent que j’écris un livre sur ce disque, ce film. Ce sera pour bientôt (ça progresse bien, mai 2020, et, scoop, le titre ne sera plus Nyman en Mai… désolé Louis qui Maille, désolé joli holy month of May, mais la sève monte d’ailleurs, et plus haut…). Enfin selon une vitesse s’inscrivant dans le long terme d’un temps éternel, résolument ailleurs, là-bas, bien loin devant. En ce quand où les choses humaines du jour le jour n’ont plus guère d’importance. Soit, précisément, bien que sans égal, le message que ces compositions (rencontrée à leur sortie en CD, vers 1989, cad en même temps que plusieurs disques cités ici (Morrissey, Beastie Boys, 22 Pistepirko et John Cale) ou d’autres, comme les Fratres d’Arvo Pärt qui, eux aussi (notamment l’ouverture de Kremer et Jarret ou l’hommage à Britten), ouvrirent ma compréhension des temps musicaux à laquelle m’avaient déjà introduite les musiques savamment écrites), à travers leurs boucles et superpositions d’un si anachronique monde musical m’inspirèrent à coup répétés de bains auditifs du genre de ceux que, dans un appartement aquarium, j’avais entamés par la danse depuis des années, avant de parler bien sûr, ce qui arriva d’ailleurs relativement tôt. Nyman minimal ?
/*=/*=/**=/***=/**=/*=/ #12-15 (10/1/18)
Pour sauter le pas de l’an, on reste en lusitanie avec Antulio Madureira et Ala dos Namorados. Deux disques qui n’ont probablement pas plus à voir entre eux que le Brésil et le Portugal…
  |
Puis avec ces deux albums où brille le toucher de Paco de Lucia et le groove pas que flamenco : Calle Real de Camaron de la Isla et sur ces reprises du répertoire de Manuel de Falla.
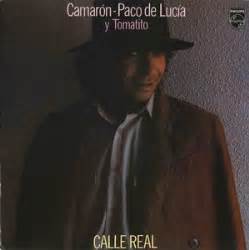  |
–%–###16-17-18###–%–
5/3/18
Codéine, Frigid Stars LP. 1991.
Ce disque de post-rock avant l’heure, terme sur lequel je ne tengo nada à dire de plus, précisément du fait que ce terme est effectivement arrivé après la bataille, a amorcé chez moi un nouveau départ. Ses volutes de veille inagitée, ses défoulages volontaires et ses lumineuses mélodies, ses accords d’un genre autre, l’harmonie rimant dans le trio et plusieurs autres choses dans le genre m’ont totalement pénétré via l’ouïe, pas XIV, non. L’ouïe à 15, royale. Le grunge en pleine culbute d’auto-topsie. J’étais pourtant dans mon univers avec ces froides constellations qu’engendrent parfois dans le cerveau d’autres galaxies (on ne parle plus, dans ce cas, de « planète » ni d' »étoile » pour désigner un humain différant de nous sous quelque aspect qu’on choisisse de se placer, genre pas mal relatif bien sûr…) cette drogue sous la bannière de laquelle le groupe sembla d’emblée se trouver. 25 ans plus tard, ça joue encore à l’occasion dans ma tête. On sait pourquoi. Mais ce qu’on ne dit pas une fois rappelé que nos connexions nerveuses datent de nos adolescences, c’est ce que ça fait réellement. Comment cela se fait non plus d’ailleurs.
Je ne saurai pas le dire, je n’y pense pas tous les jours et précisément cela advient quand on ne veut pas y penser… Mais je retiens le tremblement de terre de « Cave In », ses silences, sa nudité aussi. Je retiens, comme un improbable équivalent renversé des avalanches de cordes que Robbie Basho, tant mal que bien, aligne dans « Song of the Snowy Ranges », le vide entêtant de cet appel au soleil auquel tend la minimale, mais tellement efficace et synthétique dernière pièce du disque (laquelle fut d’ailleurs reprise par Diabologum). Le son distordu alternant avec celui clean de « Cigarette Machine », comme un rush de nicotine ou, plus fort encore, et de loin, d’envie de nicotine-goudron-tabac-agents de toutes sortes à inhaler pour s’évaporer dans une distorsion volutant vers les bouches d’aération d’un monde qui doit bien avoir une sortie quelque part… Ici, la parole prend le pas sur le chant. Naturellement. Dans ce monde inversé, comment voulez-vous avoir ne serait-ce que le goût d’ajouter à son message une quelconque fioriture ? Supplément inadéquat pour âme perdue. Inutile. Quand il s’agit de survivre en Occident rose bonbon ou gris métal, comme on voudra, l’habitude n’est pas nécessairement baroque. En tout cas chez les Protestants étrangers à la mare nostrum latine et musulmane… « Old Things » me semble vouloir couper court, lentement s’entend, à coup de larsen – émergeant à chaque nouvel accord tenu –, avec tout ce qui doit, de cette Babylone, être balayé et nettoyé d’une grande crue du Nil de la vie vraie. Reste du limon se souvenant qu’il n’est que poussière susceptible de fleurir où il se dépose, voilà ce que me semble se destiner à incarner la musique de Codéine. Comme née dans le bitume, mais respirant en pensée l’air pur du grand ciel étoilé. Étoiles glacées peut-être, mais assurément, de manière fort rassurante. Du moins autant que peut l’être une mélodie qu’on finit par trouver parmi les décombres alors qu’elle nous dit, en même temps venir d’ailleurs, d’étoiles brillantes et probablement chaudes, brulantes même. Depuis leur infinie distance, ces soleils d’on ne sait quels systèmes ne brillent-t-ils pas sur nous d’une chaleur que seuls les camés et les paumés et les troubadins et les salles timbrés branques peuvent saisir ? Eux qui n’ont rien à faire d’autre que de veiller consciencieusement tard, mais qui justement savent prendre le temps de le bien faire, c’est-à-dire de méfaire. Fut-ce à coup de ralentissements induits. Accentués, forcés, échappés. Leur art devenant alors, précisément, musicodéinitique…
Kristin Hersh, Hips and Makers, 1994
J’ai déjà parlé de Kim Deal et de ses millions de soeurs débridées. On reparle d’elles ces jours-ci. Kristin est un autre must. La Kristin de ces Hips and Makers, chantant qu’on en a bien vécu des bons moments, il m’avait semblé la rencontrer en toute intimité. Nous parlions une langue commune (son single au clip de bougies étant basé sur les mêmes trois accords que ceux qui avaient supporté mon « The Last Condemnation » composé en 1993 et sonnant, sans plagiat non plus, comme un autre titre envoûtant du premier LP de Mazzy Star ou un moment de grand délire sur le Waka Jawaka de Zappa. Si tout se passe bien, le prochain EP SGZ184 devrait, tel une boucle bouclée, contenir « Le Monde Change », nouvelle version de ces trois accords G/D/Am et ce fut fait avec l’aide d’EhrAr, Seek for Ever : https://benlaba.bandcamp.com/album/autoplay-2). Merci Kristin d’avoir trouvé des artifices si grands pour inviter les esprits candidats à l’émerveillement guitaristique à se trouver leur ciel (là encore, comme chez Codéine ou le Wilde de la Ballade de la geôle de Reading, il s’agit de regarder au ciel avec frénésie) à coups de danses tournoyantes, bien qu’assises, réalisées sur touches, de clavier aussi, mais toujours sur touches douces au toucher une fois acquise la douleur et la corne… Kristin, quand tu doubles tes voix, j’en prendrai des chorales entières ! Et Stipe n’a rien à voir là dedans ! Si ce n’était que ça me direz-vous… Mais non. Les instrumentaux sont complètement débiles mentaux ! De ceux qui justifient qu’on se taise pour plusieurs siècles. Aussi je ne m’épancherai pas, par respect. D’ailleurs, je ne sais pas comment tu as vieillis Kristin idéale, amie, fiancée, grande sœur, cousine, mère que je n’ai osée rapprocher depuis ce disque. Comblé. Pas besoin d’en savoir plus, d’accumuler, dépenser, risquer la déception aussi… D’ailleurs, on m’a dit que c’était pas trop ça. Je demanderai à voir, car j’en doute quand même. Enfin, pour la forme je garde tout ça bien ouvert. Je t’ai toujours fait confiance, et même si on te sait cyclotimique dès la première écoute de « The Letter ». Faut dire que t’en as vu avec cet autre « Loon » (pièce à écouter en entier pour savoir ce que c’est que de s’en sortir…). Que voulez-vous, entre la routine des semaines modernes et la vie de chantier émotif, j’ai choisi. Et Tu pourras, toi ou une autre, me traiter de loon à mon tour. Depuis tes hauts et tes bas, Kristin, je sais qu’on sera toujours deux : la musique et moi.
Red House Painters, 1993
Ce que j’aime avec cette histoire d’album héponyme, c’est combien le second, censé sorti après donc, est moins produit, moins léché. Pas étonnant tant ce premier LP avait atteint de telles hauteurs qu’il était évident qu’on ne pourrait jamais y retourner. Condamnés qu’on était à redescendre sans fin de ce supérieur état où nous conduit, convie le bien nommée « Down Through ». Un état d’Amérique amère d’après guerre civile et déconfitures socio-raciales en tout genre dont ces montagnes russes rouillées, symboles d’une enfance déclinée à toutes les heures de l’entropie de la vie, en sépia, rend assez bien l’humeur. L’Amérique sans fard. Je me trompais bien sûr. D’autres lumières allaient venir. Mais au fond, j’avais raison.
« Things mean a lot in the time, nothing later »
Un ami venu d’Amérique avec ce disque dans se bagages me le vendit. Il ne lui plaisait pas. Trop sombre. Sans savoir raisonnablement, je savais que je connaissais cette musique depuis son intérieur. Sans savoir, je savais que c’était Mark et moi qui avions des choses à nous dire. Enfin, Mark en avait à dire à nous, ses auditeurs du monde. Car ça a plutôt bien pris, me semble. Mark, ta voix et tes guitares, les jeux de tes amis aussi (la fameuse batterie à un coup par minute et crescendo de « Funhouse »), vous nous en avez fait faire du chemin… Ton disque parfait, 9 mois de galère à 12heures de studio par jour a porté ses fruits Mark. Jalon Mark, Landmark (comme le titre un de mes instrumentaux inédit rebaptisé « Jalon d’automne » mais qu’on peut entendre en partie au milieu de ce collage-ci https://soundcloud.com/benlaba/pot-pourri-oct2017) dont j’appris (car j’ai peu lu sur toi, de toi autre que tes chants) quelque part que tu aimais les Cure et Nick Drake (parmi d’autres) et que donc, en cela, tu rebalisais une route pavée mienne. Une route pour laquelle je suis né. Une route unique faite de contacts multiples et de grandes lumières, comme celles de chacun. Une route susceptible de dire le vide autant que le plein. Une route qui, comme tu l’accumules souvent dans tes compositions, s’engendre elle-même en devenant son propre terreau, comme un canon sur lequel s’étire et s’enroule l’espace-temps consécutivement à ce qui fut possible l’espace d’une fraction de flick dans ta tête et donc dans la nôtre. Les larsens de « Mother » ne deviennent-ils pas des cris de baleine ? Les idées simples poussées au bout, à bout de patience de l’auditeur pressé, sont autant de genres musicaux en germe. Tu as tout repris et tout rénové Mark. Merci. Tu nous as emmené ailleurs, toi qui ne rêvais que d’être emporté loin de cette relation à laquelle tu ne comprenais plus rien. Et nous non plus. Merci Mark. On n’est pas morts. Tu nous en a donné des preuves à mesure qu’on le croyait presque… Accident de voiture, accident de vie. Les entrelacs de nos vies sont faits pour dire combien c’est parfaitement que tout ceci se donne à vivre. Mark, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir. Seul, après tant de refus et d’incompréhension. Merci de ne pas avoir lâché. Merci de nous avoir montré le chemin des montagnes russes américaines, rouillées, sépias et pourtant si fraiches et limpides. D’ailleurs Mark, à ce propos, si l’on sait combien est versatile ta guitare du fait de toutes ses déclinaisons (folk, nylon, électrique, open tuning compris, etc), et puisqu’on est entre nous, je me permets de te dire que ton piano me manque. Pourquoi n’en joues-tu plus ?
*/*#19#*\* The GLADIATORS – Dreadlocks The Time is Now
3/mai/18
 Avant « la fête à Figeac 1994 », je me suis acheté mon premier disque de reggae : Natty Dread dans un supermarché de Castelnau-le-Lez. Pendant un an, jusqu’au bac et au printemps qui le précéda et qui rimera à jamais en moi avec le bourgeonnement d’appétits fondamentaux, s’en suivirent de joyeuses heures de partage avec le naissant Seek Extense!. Un aîné Peul nous avait rejoint quelques jours dans l’aventure lotoise, confirmant le bienfondé de toute cette migration des âmes et des symboles émanant des Amériques noires depuis que Garvey, Bowell et une certaine doctrine avaient trouvé musique adaptée à leur corps pensants. Nous en sommes encore là, non ? Mais à coup de bien réels battements de baguette, de très concrets frottements, grattements de guitare, de toutes ces micro-ondulations organiques, de toutes ces heures de danse et d’écoute vouées à discerner d’où vient le vent, à supposer où il va, comment, et pour combien de temps, les choses changent. Ont changé. Et le temps pour Griffiths et les siens, un autre triovocal.ja, c’était alors les 70’s. Pour moi, presque vingt ans plus tard, la compréhension des lois rasta était en procès. Notamment celles musicales. Celles que quelques années à peine plus tard, les triolets de l’Océan Indien, de Kaya à Rouge Reggae en passant par Racine des Îles ou Ras Natty Baby, allaient muter définitivement à mon oreille de Zorey voulant « apprécier ». Celles que ce soir je retrouve, réalisant un vieux dessein, celui d’apprendre à jouer les parties drums de cet album, parties si riches de clarté et absolument anti-redondantes, jouées entre autres par le Horsemouth du film Rockers . Le message encore s’insinue en moi, nouvellement certes, mais il me revient : « Be Wise to Know Your Culture »… Révérence aux Jamaicains et à la diaspora éternelle d’en chacun car « nous ne sommes pas de ce monde ». Sur les ailes de voix d’anges des shanty town, par un renversement tout carnavalesque, mais se jouant à présent à l’année longue, chose historique et comme permanente depuis qu’existent de tels enregistrements sortis des sous-sols de l’Empire, nous voilà arrivés en vue d’autre chose. Nous sommes « prêts », n’est-ce pas ? Sinon, y a qu’à. C’est maintenant ! Anyway, « A Day We A Go/I Said No Skid Ya/Hold on to this Feeling/And Move Ya » !
Avant « la fête à Figeac 1994 », je me suis acheté mon premier disque de reggae : Natty Dread dans un supermarché de Castelnau-le-Lez. Pendant un an, jusqu’au bac et au printemps qui le précéda et qui rimera à jamais en moi avec le bourgeonnement d’appétits fondamentaux, s’en suivirent de joyeuses heures de partage avec le naissant Seek Extense!. Un aîné Peul nous avait rejoint quelques jours dans l’aventure lotoise, confirmant le bienfondé de toute cette migration des âmes et des symboles émanant des Amériques noires depuis que Garvey, Bowell et une certaine doctrine avaient trouvé musique adaptée à leur corps pensants. Nous en sommes encore là, non ? Mais à coup de bien réels battements de baguette, de très concrets frottements, grattements de guitare, de toutes ces micro-ondulations organiques, de toutes ces heures de danse et d’écoute vouées à discerner d’où vient le vent, à supposer où il va, comment, et pour combien de temps, les choses changent. Ont changé. Et le temps pour Griffiths et les siens, un autre triovocal.ja, c’était alors les 70’s. Pour moi, presque vingt ans plus tard, la compréhension des lois rasta était en procès. Notamment celles musicales. Celles que quelques années à peine plus tard, les triolets de l’Océan Indien, de Kaya à Rouge Reggae en passant par Racine des Îles ou Ras Natty Baby, allaient muter définitivement à mon oreille de Zorey voulant « apprécier ». Celles que ce soir je retrouve, réalisant un vieux dessein, celui d’apprendre à jouer les parties drums de cet album, parties si riches de clarté et absolument anti-redondantes, jouées entre autres par le Horsemouth du film Rockers . Le message encore s’insinue en moi, nouvellement certes, mais il me revient : « Be Wise to Know Your Culture »… Révérence aux Jamaicains et à la diaspora éternelle d’en chacun car « nous ne sommes pas de ce monde ». Sur les ailes de voix d’anges des shanty town, par un renversement tout carnavalesque, mais se jouant à présent à l’année longue, chose historique et comme permanente depuis qu’existent de tels enregistrements sortis des sous-sols de l’Empire, nous voilà arrivés en vue d’autre chose. Nous sommes « prêts », n’est-ce pas ? Sinon, y a qu’à. C’est maintenant ! Anyway, « A Day We A Go/I Said No Skid Ya/Hold on to this Feeling/And Move Ya » !
°°°19°°°
2mai2020 – Cette fois je m’épanche un peu…
« Please don’t pass me by » nous est adressé à la fin du morceau… Tu la vois la caravane aboyer ? Toi, le chien sans nom, silencieux, lorgnant vers le couchant, bavant, affamé, malade et prêt au moindre geste d’appel à lui emboîter le pas à cette cohorte de Sauvages que d’autres s’évertuent depuis 50ans à ne pas entendre pour mieux continuer à faire leur usual business. Chiens de trempes toutes autres que la tienne, semble-t-il… « Twice born Gypsies », tu dormiras dans cette maison, quand d’autres s’y glisseront, y passerons, mais n’y resterons pas autant que toi. Toi, famélique, chétif gueux du matin, assoiffé, tu y es entré, sans plus d’attente, trop écume résumée de la vie extérieure tu n’en attendais en tout cas pas l’ordre stellaire que tu y as trouvé ; les sources, les mines, les courants de fond et l’arche glorieuse libérant ses énergies depuis le bout de la caverne. Les graines semées ont donné, tant et tant ; ta chevauchée solitaire t’a légué le fruit initiatique d’une semence nouvelle, laquelle ne fleurira que lorsque les anciennes confusions seront ultimement balayées, dépourvues d’histoires solides faisant face à la Couveuse Eternelle d’un Monde changEant, se réunissant, se multipliant, se réarrangeant jusqu’à la prochaine mélodie à remonter le Temps.
Les 13th Floor Elevators, les « iliviètors », je les ai rencontrés par cet album et donc par son premier titre : 8 minutes épiques d’une changeante tout en statique, cet effleurement d’un lotus au nombre infini de pétales qu’on ne comprendrait pas mieux en étant de langue maternelle de la mère Erickson (ni donc celles de son fils, Roky, le compositeur chanteur, ou de l’auteur des textes, Tommy Hall —qui est aussi le joueur du jug branché sur l’effet de vibrato pour la seule fois de l’Humanité—, des deux Danny, les nouveaux venus à la basse et batterie, et pas plus de Stacy /// Note 1 : dont le riff final sur ce morceau se retrouve dans « She lives (in a time of her own) » et qui fonde aussi tout le titre « Livin up » de l’album suivant, Bull of the Woods, s’est retrouvé au final de mon « C’est Ainsi » (Cf. BenLaBa SGZ181). Comme quoi, oui, la musique a bien sa vie propre au large du continent du langage. fin de note///), minutes ouvrant sur l’ailleurs parmi les plus littéraires et mystiques que la musique américaine ait su créer sous un déluge de sonorités rock (et blues de Blancs, nimbées du yoyo sonore oscillant à mesure que décollent les mots criés, car, oui, Roky ne chante jamais comme un autre le ferait, et les rugissements roulants d’une basse jouée par un singe mendiant des gouttes d’or sous la lune, arrosé des cristallines écorchures des distorsions multiples d’originales guitares revenant et déguerpissant sous l’orage, saturant l’avenir, libérant le passé de ses jougs, démissionnant le présent de ses gonds d’une force des moins comparables, alors que la batterie (et les percussions ! qu’on n’entend pas aussi bien sur toutes les versions de ces bandes à moitié sauvées du Néant du Temps) te redit les rythmes hypnotiques d’une sorte de sagesse physique, toute —et rien que— tellurique, n’ayant d’équivalent que les tremblements de terre (« Earthquake » est le début de la face B), que débâcles, torrents de lave, effluves d’une fumée de feux de continents entiers, alors que le Verbe, en toute acceptation de la Maya te dit toute sa fougère d’arborescence illusoire, ses codes de toute façon perdus depuis autant de lustres que les sceaux explosés d’un monde finissant et que ni les mères des uns ni des autres n’avaient pu même imaginer en songes, rêves ou cauchemars.
Il n’y aura plus de saison après celle-ci. La Pâques, l’Easter est à présent partout, Everywhere. Je suis né à nouveau. Une fois de plus. Ce disque, ces hommes, ces Omious, ces nouveaux humains d’une secte sans nom, les Nomious, les Unanomious, mes Humains d’amour réel, ces humains éduqués à la baguette en plein Texas, s’étant rééduqués en anciens cracheurs de feu de cactus aux coyotes mûrs, ces métis d’Indiens de la frontière, ces sans âge d’un monde en pleine construction qu’il s’agissait déjà de décepter, de détourner, de dérouter pour lui dire que les coyotes, les cactus, le feu, les astres, les Indiens, la frontière, même les Âges n’existaient pas comme on les avait présentés jusqu’ici…
Ces choses ne se comprennent jamais bien tu me diras… Alors autant les chanter. Autant s’appeler les « ascenseurs » dans un monde commençant à grimper un peu trop haut afin de se présenter comme une autre voie possible d’ascension générale : celle du psychédélisme, le mot apparaît avec le groupe. Et, alors que d’autres cherchent à s’agripper, pourquoi ne pas se donner un état fixe qu’ils puissent comprendre, un état provisoire du moins, celui du 13e étage tient, pourquoi non ?, celui que, par superstition, on ne nomme jamais en Amérique du Nord… Autant les vibrer et les balancer ces choses dans l’univers. Peut-être que parmi les auditeurs lambda, atomes humains directement alentours ou pas, comme moi, incapable en bout de ligne de nommer ce qu’est un Omious, un Hommium, un harmonium à deux pattes, croisé d’un clavecin et de cornemuses mêlées aux sistres et tambours divins des déserts des Etats d’un Sud qu’aucune plantation n’aurait su enrichir d’un quelconque esclavage africain, peut-être que parmi les auditeurs il se trouvera quelqu’un qui entendra l’appel et montera à sa propre vitesse sur les épaules de l’air vers un Monde Nouveau, meilleur… Car ici, entre les yeux du serpent et ceux d’une constellation qui te gèle sur place dans la nuit bleue d’un univers lunaire, il n’y a que très peu de vie possible. Et quand on y pense, c’est ça le risque que prirent ces jeunes gars : risquer de tuer la vie pour être sûr d’en prendre une dose tout sauf quelconque puisqu’amplifiée par des substances aux effets cognitifs les plus lourds. C’est aussi le risque que faisait peser sur eux l’Amérique les attendant au tournant, comme pour monter en exemple aux yeux de ceux qui seront restés anodins, ordinaires et ternes, qu’on ne revient pas sain et sauf d’une aventure si risquée… que l’est celle qui conduit à l’asile où elle les aura mis de force. Comme Artaud. Et certes, Roky est mort. Mais il y a peu. Et il envoyait encore du lourd. Comme toujours.
La relative impression de mystère que j’accroche à ce groupe n’a d’égal que Pâques donc, ce Renouveau, cette Résurrection annuelle de la vie de nos campagnes, de nos cellules, de nos pulsions, de nos humeurs… Ce prinTemps partout, tout le Temps, ce prinTemps du fond des âges duquel quelques milliers d’espèces vibrent actuellement autour de moi, et auquel vibrèrent donc, en leur Temps, en leur lieu, ces Texans ni de l’Est ni de l’Ouest de la musique américaine que mon panthéon met encore plus loin dans l’ailleurs d’un au-delà des choses de ce monde où sont d’ordinaire érigées celles des années 1960. Lesquelles sont quand même assez libres, excusez du peu. Mais il y a bien des raisons à tout cela. Une d’elle est simplement le fait que la reprise de Dylan contenue dans ce disque est la meilleure représentation de ce que je me fais d’une reprise, laquelle est une « variation ». Comme le disait Glenn Gould dans une présentation CBC du 3 juin 1964 :
« Shortly after the first musician has produced the first recognizable musical sound, the second human was very probably ceased by an urge to produce the second musical sound (…) All music, in that sense, is about other music. All music is possible because of other music. In that sense, all music is really variation upon some original music ».
Il y a bien ici cette volonté de propulser le morceau original servant de modèle dans une sphère qui ne lui appartiendrait plus tout à fait et qu’on aurait tramé soi-même. Et par cette réattribution, cette appropriation —qui n’est pourtant pas du tout une prise de possession, bien plutôt une façon de lâcher-prise total offerte par ce jeu de syntonisation et de libre imitation (combien d’inepties entend-t-on en la matière, combien de ressasseurs sans nom, sans son, sans ton pour des originaux eux-mêmes souvent inutiles… ce que le « Baby Blue » de Dylan n’est d’ailleurs pas)—, bref, par la version devient possible de vivre une réalité différente tant de la sienne propre que du modèle original qui diffère ainsi de son soi-même… La Création en somme, vécue en miniature par ce trafic qui fait qu’on se sent être, qu’on devient en se branchant sur une mélodie venue de l’espace et y retournant, mais pas avant qu’on ait pu y apposer sa marque, sa fabrique, son geste, lequel est nécessairement le plus beau possible, selon les moyens du bord, les acquis et les lacunes, les illuminations et la part d’ombre des bricoleurs célestes servant de relais dans l’infini.
Voilà ce qu’aura été Easter Everywhere pour moi, un relais empoigné sans m’y attendre, (Julian Cope et mon frère y étant pour quelque chose) vers l’âge de 12 ans, mieux écouté depuis mes 14, et à propos duquel je ne dirai jamais que le meilleur du bien. Les superlatifs devraient vous exploser au cerveau d’eux-mêmes… au risque des ombres, des feux, des Dieux, des Juges, des Diables et des sauvages du désert, des lézards du chemin aux cactus ; au risque de la fée électrique, des âmes du Purgatoire nucléaire, des Anges des constellation virales (au fait, allez demander à Jerry Lee Lewis de quoi il en retourne dès lors qu’il s’agit de faire du rock dans le Sud, pourquoi pas en lisant Nick Toshes, Burrougs ou Faulkner, et voyez les liens de tout ça avec Dieu) ; au risque aussi des bien étranges résultats de studio, parmi les plus pourris possibles en un sens (///Note 2 : En fait, la réalisation de l’album s’arrêta avec les fonds disponibles alors que s’accumulaient encore les réenregistrements sur les premières prises directes du groupe entier qui devaient conduire à l’album idéal (ce qu’il est quand même, à ce stade de la matière…). L’été 67, passé dans une cabane, assignés à résidence au Texas pour possession de drogue, servit à modeler ce son hors norme —qu’il faut donc absolument écouter en mono— comme plein d’humidité, de chaleur nocturne, de vapeurs, de sueurs, comme si l’Esprit et la Matière s’étaient mêlés à mesure que se joignirent les personnalités musiquantes de cette baroque élaboration que bien des rééditions, même audiophiles, n’auront pas su recombiner ///fin de Note), qu’une musique comme celle-ci, venue de là-bas et y retournant, vous y emmenant pour sûr, ne peut qu’amplement confirmer comme très secondaires là où il s’agit de verticalité et non pas de simple « matériel » (terme employé d’ailleurs par les Kapitalistes anglophones pour dévaloriser les oeuvres de lumière révolutionnant leur monde). Ce disque devrait faire oublier d’au moins 100 milles lieux la soupe musicale servie à grande échelle depuis, ici comme là, à renforts d’artifices aussi abscons que délétères pour la communion des sens (///Note 3 : C’est précisément le sens que je mettais dans une des premières composition du Seek Extense! Dont le titre faisait d’emblée allusion à l’efficacité symbolique de ce disque culte dans mon multivers. Précisément, « Evil Everywhere » (1994 cf. ici https://benlaba.bandcamp.com/album/evil-everywhere-20e-anniversaire ) peut se résumer en un culte d’exorcisme chamanique vécu durant une improvisation de 45 minutes (dont ne restèrent que 15, celles libre sur cette Face de K7) à plusieurs. Les 5 musiciens n’avions pour seule consigne que d’alterner deux pôles d’activité musicale : l’un plutôt calme reposant sur un bourdon de ré, l’autre mouvementé correspondant à une monté chromatique d’un octave à partir du mi, et donc de suivre, à mesure que nous les découvrions, les possibilités infinies empruntées par le passage entre ces deux états eux-mêmes indéterminés. /// Fin de Note). La même semaine de novembre 1967 où sortait cet album passé, sur le coup, à la trappe des clinquantes actualités normalisées dans leur pseudo-rébellion qui allait donner des Sir Ceci-Cela de sa Majesté, imaginez donc…, parut un Stones, qui fit florès, lequel s’était inspiré du Sergeant Pepper, lequel dépendait à son tour du Pet Sounds et du « Good Vibrations » des Beach Boys, lequel lorgnait probablement autant vers les cultures chamaniques que la symphonie baroque, lesquels tissaient leurs liens vers… Alors, on descend ou on monte ? Tu sors à quel étage ? Moi, je reste… en mono « Levitation ».